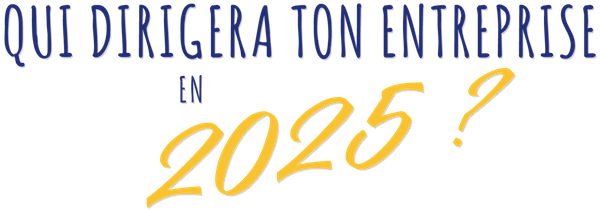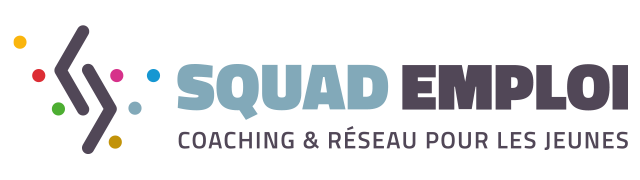L’Observatoire de l’Eco-anxiété, porté par Econoïa, en partenariat avec l’ADEME et avec le soutien d’E5t, vient de publier pour la première fois une étude sur le sujet. Si elle ne doit aujourd’hui plus être minimisée ou ramenée à un phénomène de mode, l’éco-anxiété ne doit pas non plus « être réduite à un argument idéologique négligeant les souffrances des éco-anxieux ». Tour d’horizon des principaux enseignements.
L’éco-anxiété se définit comme un « état psychologique de détresse mentale et émotionnelle qu’un individu peut ressentir en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes environnementaux mondiaux ». Pour la première fois en France, une étude s’est intéressée à ce sujet. Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont pas forcément les plus concernés par le phénomène. Celui-ci toucherait davantage les 25-34 ans, tranche d’âge qui présente le score moyen le plus élevé. Les jeunes de 15 à 24 restent cependant touchés par l’éco-anxiété, et plus exposés, comme les 25-34, à des risques en matière de santé mentale. À l’inverse, les 50-64 ans sont moins disposés à développer des symptômes éco-anxieux. Autre enseignement : les agriculteurs sont les plus prédisposés à développer une éco-anxiété. Enfin, l’étude révèle l’influence du lieu d’habitation : « à mesure de l’augmentation de la taille de la ville, les préoccupations pour la crise environnementale et les symptômes associés sont plus importants ».
Un enjeu de santé publique
L’étude explique également que, contrairement aux idées reçues, cette éco-anxiété peut permettre « à un l’individu éco-anxieux de maintenir une santé mentale positive, en passant à l’éco-action ad hoc et en nourrissant un engagement en faveur de l’environnement. Dans d’autres cas, l’éco-anxiété peut devenir paralysante » Car si l’éco-anxiété n’est pas une maladie, elle peut rendre malade : l’étude révèle que 2,1 millions de Français seraient très fortement éco-anxieux, au point de devoir « bénéficier d’un suivi psychologique, avec un risque pour 420 000 d’entre eux de basculer vers une psychopathologie tierce connue (dépression réactionnelle ou trouble anxieux) ». Autrement dit, l’éco-anxiété devient aujourd’hui un enjeu de santé publique : « Au-delà des actions possibles en lien avec la transition environnementale, il faut se rendre à l’évidence aussi que l’éco-anxiété est un enjeu de santé mentale voire de santé publique ». L’étude préconise plusieurs actions comme la création d’une chaire de recherche ou le fait de pouvoir donner accès en ligne et gratuitement à l’HEAS-VF, afin que les Français puissent effectuer un autodiagnostic et bénéficier d’un premier conseil psychologique en cas de résultat indiquant une menace sur leur santé mentale.
Une opportunité pour agir
L’étude se termine sur une note plus optimiste, indiquant que l’éco-anxiété peut « devenir une force positive d’adaptation et de résilience en prévision de la multiplication des évènements alimentant la crise environnementale ». En effet, l’étude souligne que « l’éco-anxiété est une chance car elle peut aussi contribuer à faire évoluer le système thermo-industriel dans lequel nous semblons enfermés, pour en limiter ses effets délétères, grâce à l’un des leviers dont chaque citoyen dispose, son pouvoir d’agir ». Enfin, l’étude indique que « faire face à la montée de l’éco-anxiété n’est pas irrémédiable à condition d’agir au niveau individuel, collectif et sociétal. Au niveau individuel, pour rassurer les personnes (éco-anxieux et entourage proche : famille, amis, collègues) quant au mécanisme de l’éco-anxiété et a son issue potentiellement favorable si elle est prise en charge. Au niveau collectif, pour mailler les réseaux des acteurs (personnels de soin, employeurs et associations) quant à la prise en charge et l’accompagnement des éco-anxieux ».

 Les sites de l'ecosystème Réseau Alliances
Les sites de l'ecosystème Réseau Alliances